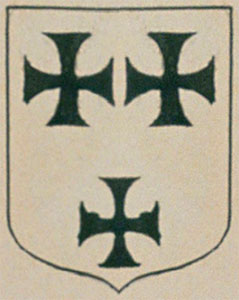Saint-Pierre de Blesle est un ancien monastère bénédictin de femmes, fondé dans la seconde moitié du IXe siècle par Ermengarde († 890), comtesse d’Auvergne, épouse de Bernard Plantevelue († 886). Ermengarde et Bernard furent les parents de Guillaume Ier d’Aquitaine (v. 875-918), fondateur de plusieurs maisons monastiques, dont l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire).
La fondation de Blesle eut lieu à une date incertaine entre 849 et 885, probablement vers 865. Le pape Serge III (901-911) plaça le monastère sous le vocable de saint Pierre et lui accorda le privilège d’exemption, bénéfice renouvelé à plusieurs reprises par d’autres pontifes et qui dura jusqu’à son affiliation à Cluny. Lors de la fondation, la comtesse donna au monastère les terres qu’elle possédait en ce lieu, comprenant plusieurs églises et paroisses placées sous l’autorité directe des moniales.
La tradition rapporte qu’Ermengarde se retira dans ce monastère et qu’elle en fut même la première abbesse, mais l’historien Du Tems (1775) mentionne Emilde comme première abbesse, contemporaine de la fondatrice. Ermengarde mourut en 890 et fut inhumée dans l’église. La maison connut une longue période de prospérité : les abbesses de Blesle exerçaient un pouvoir seigneurial, souvent en conflit avec les seigneurs de Mercoeur, avec lesquels elles rivalisaient pour l’autorité. Les Mercoeur parvinrent à s’implanter à Blesle en y édifiant une forteresse, malgré l’opposition de la communauté bénédictine qui avait déjà commencé à perdre son influence.
Si, à l’origine, les moniales menaient une vie communautaire, au XIVe siècle elles assouplirent les règles et purent disposer de maisons ou d’appartements privés, avec leur propre domesticité. Il convient de rappeler que la communauté était composée exclusivement de femmes issues de la noblesse. À cette époque, le territoire et le monastère furent touchés par la guerre de Cent Ans et par les incursions des armées de mercenaires. À partir de 1530, la charge d’abbesse devint une nomination royale et, entre 1628 et 1633, Saint-Pierre de Blesle fut rattachée à Cluny, perdant une grande partie de son indépendance et de sa capacité de gestion. En 1789, déjà en pleine décadence, elle devint le siège d’une communauté séculière de chanoinesses, mettant fin à la tradition bénédictine. Tout disparut avec la Révolution.
Aujourd’hui, l’église est encore conservée, bien qu’elle ait subi de nombreuses modifications dans sa structure : elle possède une petite nef et un long transept menant à un chevet démesuré par rapport au reste de l’édifice. Certaines parties pourraient remonter à la première époque du monastère, peut-être au Xe siècle, mais l’essentiel de l’édifice est postérieur. Elle conserve d’intéressants éléments de sculpture, ainsi que du mobilier. Autour de cette église Saint-Pierre subsistent encore les résidences privées des moniales, sans doute construites jadis autour d’un cloître aujourd’hui disparu.
- ANÒNIM (s/d). Blesle. Visite dans son passé. Les Amis du Vieux Blesle
- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé
- CRAPLET, Bernard (1972). Auvergne romane. La nuit des temps, 2. Zodiaque
- DU TEMS, Hugues (1775). Le clergé de France, vol. III. París: Brunet
- DUCAS, M. (1843). Les chapitres nobles de dames : recherches historiques, généalogiques et héraldiques sur les chanoinesses régulières et séculières. París
- FRAMOND, Martin de (2013). Notes sur l’histoire des Bénédictines de Saint-Pierre de Blesle (IX-XVII siècle). La place et le rôle des femmes dans l’histoire de Cluny. Brioude: Créer
- MATHIEU, Jean-Noël (2007). Recherches sur Ermengarde, mère de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Revue belge de philologie et d'histoire, vol 85
- PHALIP, Bruno (2013). L’architecture de l’aabbatiale de Blesle et son environnement. La place et le rôle des femmes dans l’histoire de Cluny. Brioude: Créer
- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia
- SAINT-PONCY, Léo de (1869). Notice historique sur Blesle et l'abbaye de Saint-Pierre-de-Blesle. Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy. Vol. XXIX. Le Puy. Marchessou